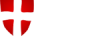Le vieil Annecy

Le vieux Annecy est le quartier historique de la ville. Il ne faut pas le confondre avec Annecy-le-Vieux qui est une commune adjacente beaucoup moins touristique.
Balade dans la vieille ville d’Annecy

Découvrir la vielle ville d’Annecy à pied grâce à ces deux parcours facilles
La réserve naturelle du bout du lac d’Annecy

Cette zone marécageuse située à l’extrémité sud du lac d’Annecy abrite une grande diversité d’espèces animales et végétales, dont le Castor d’Europe
Les Allobroges

Le chant des Allobroges date du 19ème siècle. C’est l’hymne de la Savoie. Ses Paroles ont été écrites en 1856 par Joseph Dessaix en 1856
Les cristaux du Mont-Blanc : une fascination qui perdure dans le temps

Connus depuis la Préhistoire, les cristaux de quartz ont traversé les siècles en fascinant les hommes de toutes conditions. Ceux du Mont-Blanc sont réputés dans le monde entier. De formes, […]
Quand la nature sculpte les lapiaz

Tous les jours nous pouvons contempler le travail que l’érosion effectue depuis des millions d’années sur les roches terrestres. Sommets déchiquetés ou arrondis, falaises, cols, canyons sont les résultats les […]
L’histoire des clochers à bulbe de Haute-Savoie

Depuis longtemps intégrés au patrimoine savoyard, ils promènent leur architecture baroque sur fond de montagnes et de glaciers depuis la vallée de Chamonix jusque dans les vallées du Chablais, du […]
Les arbres têtards, seigneurs de nos campagnes

Arbres extraordinaires avec leurs étranges gueules cassées, majestueusement présents dans toutes nos campagnes et pourtant inconnus…